











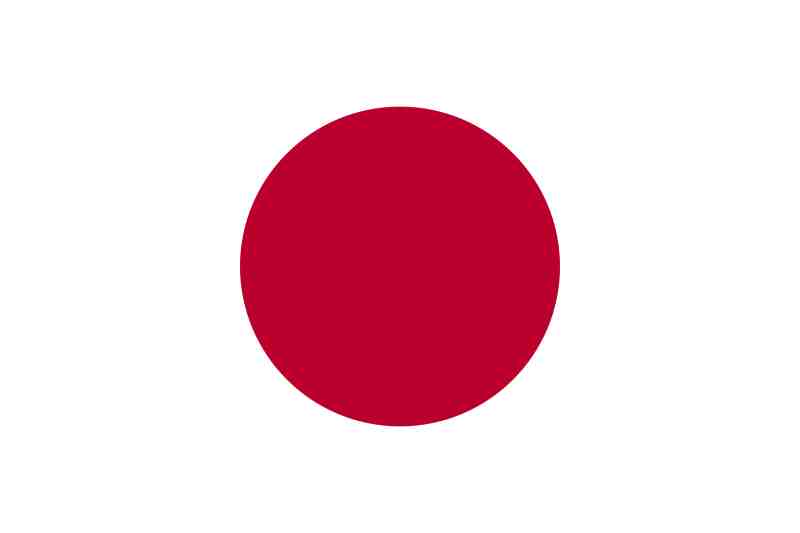





 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
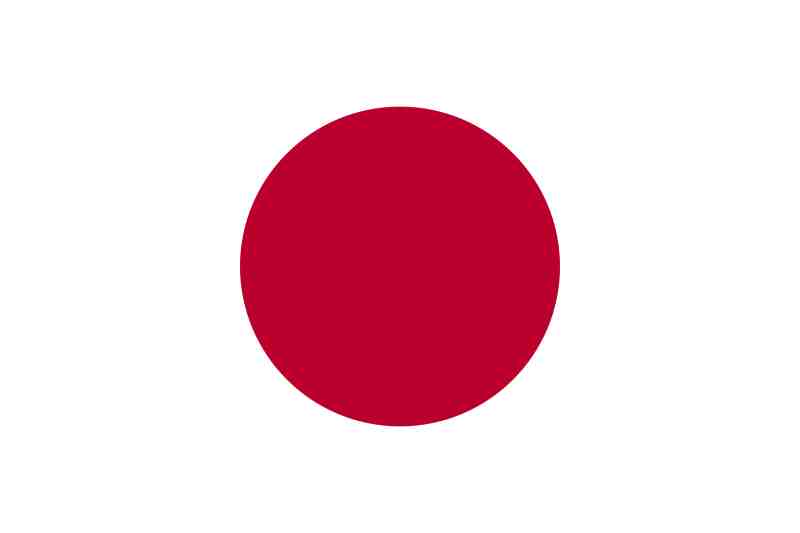 |
 |
 |
 |
 |
 |



|
Bien chers amis, De retour d’une longue visite dans deux pays voisins, le Mali et le Burkina Faso, je viens tout simplement vous en partager les premiers fruits prometteurs. « Un précieux trésor est présent dans l’âme de l’Afrique où je perçois ‘‘le poumon spirituel’’ pour une humanité qui semble en crise de foi et d’espérance, grâce aux richesses humaines et spirituelles inouïes de ses enfants… » (Africae munus, N°13) Tout au long de ce séjour, s’est vérifiée cette affirmation de Benoît XVI dans Africae munus, le document que nous attendions suite aux propositions qui lui avaient été remises à l’issue du Synode sur l’Eglise en Afrique de 2009 - auquel j’avais eu la joie de participer. Je ne vous le cache pas, ce voyage n’avait rien de désintéressé, ni de touristique ! Mon intention était d’aller rencontrer un certain nombre de Congrégations africaines et d’Evêques pour leur demander de venir prêter main forte à notre Eglise diocésaine faite de communautés fragiles où certains sentent le poids de l’âge. Voici plus de dix ans que je n’étais pas retourné au Mali et au Burkina Faso, et je me suis aperçu que les liens avec le Maghreb se sont bien renforcés. Depuis une bonne décennie, nous avons pu recevoir de nouvelles vocations en provenance des pays subsahariens, vocations qui se fortifient avec le temps, vocations qui donnent aussi à l’Eglise d’ici un visage plus universel et font prendre à la mission un tout nouveau tournant. Lors du Synode des Evêques d’Afrique, les représentants du Maghreb n’avaient cessé d’insister sur le fait que, tout en ayant des liens profonds avec le Proche Orient, nous sommes bien ancrés dans le Continent Africain. La présence dans nos communautés chrétiennes de religieux, religieuses, étudiants et émigrés témoigne de cette réalité. Par ailleurs, le Sahara se trouve être une charnière entre le Nord et l’Ouest de l’Afrique. Les échanges avec les pays frontaliers y sont courants et le double conflit que vit actuellement le Mali n’est pas sans répercussion sur le sud du pays. Quel message porter ? Aussi bien aux Evêques rencontrés qu’aux Congrégations visitées, ce fut un appel ! Depuis plus d’un siècle, des témoins de l’Evangile, traversant la mer et le désert, sont venus d’Europe. Les Eglises fondées sont maintenant adultes et prêtes à prendre le relais de la Mission. Il est vrai que cette Mission, dans les pays subsahariens, est beaucoup plus centrée sur une annonce directe du message évangélique. Pour nous, au Maghreb, il s’agit avant tout de refléter dans nos vies et nos engagements la dimension universelle de l’Amour de Dieu manifesté en Jésus Christ, sans distinction de religion, de langue, d’ethnie. Toute personne, toute société quelles qu’elles soient ont droit à notre sollicitude, à notre respect, à notre Amour. Chrétiens et Musulmans, nous sommes de la même humanité et nous devons travailler à un vivre ensemble, même si beaucoup ne l’entendent pas ainsi ! Les champs d’engagement mis en lumière ces derniers temps dans le diocèse sont autant de terrains de spiritualité et d’humanité où nous pouvons nous rejoindre : la Contemplation, le témoignage de la Charité, et le vaste domaine de la Culture. C’est globalement le contenu du message que j’ai pu semer au fil de mes rencontres. Merci à vous, Congrégations et Evêques qui avez manifesté tant d’empressement à me recevoir et tant d’intérêt pour l’appel que je vous adressais. Accueillant cet appel, vous avez exprimé votre désir de prendre ce relais dans l’esprit où nous-mêmes nous le vivons. Une
longue route s’ouvre devant nous.
|
|
Nouvelles…. Pour rester proches
● Nous avons reçu des nouvelles du P. Philippe qui s’impatiente de revenir ainsi que du P. Norbert qui nous a écrit, il n’y a pas très longtemps : « Le moral va bien, pas de problème de ce côté-là » ; pour sa santé, ce n’est pas encore ça… Nous ne pouvons que l’encourager à tenir dans la persévérance. ● La Pte Sr Hayat est arrivée à Touggourt pour quelques semaines, heureuse de retrouver sa Fraternité et ses nombreux amis. Nous lui souhaitons un heureux séjour. ● Comme il le dit dans son message, notre frère évêque Claude a fait un très bon périple au Mali et au Burkina Faso et il remercie tous ceux et celles qui ont facilité son séjour. Il a beaucoup apprécié de rencontrer les évêques de Bamako puis de Ségou. Heureusement, il a pu quitter le Mali à temps, l’avant-veille d’un coup d’état imprévisible. Déjà la rébellion du Nord était enclenchée et la population était en émoi. Sa visite au Burkina Faso luia permis de prendre contact à Ouahigouya avec les Sœurs de Notre Dame du Lac ainsi qu’avec l’évêque du lieu, puis à Bobo-Dioulasso avec l’Archevêque, mais aussi d’avoir la joie de participer à la fête de l’Annonciation… chez les Sœurs de l’Annonciation de Bobo (SAB) et de revoir le Noviciat des SMA, Pères Blancs, d’y rencontrer les novices dont quatre sont promis pour le Maghreb. De retour à Ouagadougou, il a poursuivi ses rencontres, au Centre de Philosophie des Pères Blancs puis avec la Responsable Générale des Sœurs de l’Immaculée Conception. Il est revenu plein d’espérance… ● Notre Assemblée Diocésaine approche : nous nous retrouverons le 18 avril au soir pour 3 jours de réflexion, de partage et de prière sur le thème « Aujourd’hui, une nouvelle étape de la Mission ». La dernière réunion préparatoire s’est tenue le 3 avril. Merci aux bonnes volontés qui s’activent pour son bon déroulement. Et bien sûr, vous en aurez un compte rendu détaillé ! ● Le P. Bergantz, bien connu des anciens, a été très déçu de ne pas pouvoir nous rendre visite à Ghardaïa comme prévu ; il a dû subir une opération dont il se remet bien mais doucement. Nous lui souhaitons de retrouver sa pleine vitalité. ● A
Tam, « la vie suit son cours
même si l’on sent les gens
préoccupés par la situation au Nord
Mali », tel est l’écho
donné par la communauté
chrétienne. Calendrier
de
Mgr Rault : Avril 2012
Ghardaia, Préparation de l’Assemblée Diocésaine puis Semaine pascale dans les communautés de l’Ouest (El Abiodh et Ain Sefra) et Assemblée Diocésaine à Ghardaia. * * *
|
|
(Tiré
de "Flash", bulletin du Diocèse de Tunis.
Mars-Avril 2012)
Dans le contexte actuel du Maghreb et du monde arabe en général, il est bien risqué de s’aventurer sur une telle question ! Je le ferai avec toute la réserve d’un hôte de ce pays, m’efforçant d’être plus un observateur attentif de ses évolutions récentes que juge impartial ou prophète de l’avenir ! Comme chaque pays, l’Algérie a ses spécificités, et il serait un peu hâtif de dire que ce « printemps » la traverse au même titre que ses voisins maghrébins ou proche-orientaux. Mais elle n’est pas en dehors des remous sociopolitiques qui touchent ces pays. Son identité musulmane n’est pas bouleversée par les divisions religieuses qui affectent certains pays arabes, même si elle est traversée par un mouvement identitaire qui touche la vie sociale et politique. Nous verrons le poids des partis politiques de tendance fortement « islamisante » aux prochaines élections législatives qui se préparent. Par ailleurs, la hausse du prix du pétrole la met à l’abri d’une crise économique grave, au moins pour le moment. Par ailleurs, l’Algérie, tout comme les autres pays du Maghreb, est dotée d’une importante composante « berbère » qui ne la met pas dans la droite ligne des « pays arabes ». Cette composante n’est pas à négliger. Deux autres facteurs interviennent dans cette « exception algérienne » D’une part, le pays, qui célèbre cette année le cinquantième anniversaire d’une indépendance durement acquise, a beaucoup souffert de la période coloniale. D’autre part, la « décennie noire » qui a sévi pendant les années 90, n’a fait qu’ajouter à cette longue épreuve, même si cette fois-ci, elle est venue de l’intérieur. Il n’empêche que la population aspire, elle aussi et fortement, à plus de justice et de démocratie, à un meilleur partage du pouvoir et des richesses dont le pays est pourvu. De nombreuses manifestations se produisent de façon répétitive, tournant parfois à l’émeute, non seulement à Alger mais aussi dans diverses villes de province. Il n’est pas rare que les médias notent encore des cas de « harragas », de suicides par le feu. Ces manifestations sont dues en partie au chômage, au mal vivre, à l’injustice dans l’attribution des logements, à la corruption et à un réel malaise social. Elles montrent bien que le pays est loin d’avoir trouvé sa stabilité, et l’établissement durable d’une démocratie adaptée à ses aspirations. Je lisais récemment un article qui reflète bien l’ambiance générale qui semble prévaloir : « L'Algérie attend. Elle veut du meilleur. Elle veut vivre mieux, ne plus sentir cette masse qui leste son estomac et oppresse sa poitrine. En un mot, elle veut être heureuse. Elle ne veut plus être ce pays où tout le monde a l'air malheureux, y compris ceux qui le dirigent ! Certes, à l'heure des turbulences arabes, l'Algérie connaît trop bien le système qui la dirige, ce qui explique pourquoi elle ne semble pas vouloir d'une nouvelle aventure qui mènerait à de terribles violences. Mais l'Algérie attend. Un geste, une ouverture, un changement. Un vrai changement qui libèrerait les énergies, qui donnerait aux Algériennes et aux Algériens plus de confiance en l'avenir et le sentiment de ne plus être en marge du monde et de son évolution. (« L'attente, ce mal algérien », par Akram Belkaïd - Quotidien d'Oran - 10 janvier 2012). Faut-il donc mette cette attente « maladive » sous le même chapeau que ce qui a fait éclater le « printemps arabe » ? Pourquoi ce mouvement ne se généralise-t-il donc pas? Quelques remarques s’imposent : Il faut bien le souligner, et beaucoup d’Algériens le font remarquer : l’explosion de ce printemps s’est déjà produite, mais à une autre saison : l’automne 1988 ! Octobre fut une véritable révolution. Le pays a basculé, sous la poussée violente de la rue, vers un véritable changement démocratique et une ouverture au pluralisme, aussi bien dans le domaine de l’information que dans celui de l’économie et de la politique. Comme on le voit aussi aujourd’hui par exemple en Tunisie ou en Egypte, tous les résultats espérés, ou rêvés, n’ont pas, sur le champ, vu le jour. Et vous savez ce qui en avait résulté : victoire électorale du parti islamiste radical dominant, interruption de ce processus électoral par l’armée et montée en spirale d’une violence qui a duré près de dix ans, et a provoqué environ 150 000 morts ! On ne sort pas indemne d’une telle épreuve. L’actuel Président a beaucoup aidé le pays à sortir de cette situation, et la population lui en est reconnaissante. Mais les blessures profondes demeurent, qu’un processus de paix civile et de réconciliation nationale n’a pas totalement réussi à guérir. Ne faut-il pas du temps pour retrouver sérénité, paix et confiance en soi après tant de divisions et de blessures ? Et si à l’échelle de l’actualité, dix ou quinze ans semblent bien loin dans le passé, pour des personnes meurtries, c’est comme si c’était hier. Ceci explique bien le fait que la population dans son ensemble ne tient pas à entrer dans un mouvement violent apparenté à ce qui se passe dans tel ou tel pays voisin. L’Algérie a trop souffert et ne veut pas s’engager dans un processus de violence globale. Certes, les grondements politico-sociaux font bien sentir que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes : tout est là pour mettre en branle une vague de protestation qui, cependant, ne semble pas vouloir se généraliser. Mais sait-on jamais ? Disons alors que nous sommes dans un « printemps mouvementé » qui dure, une attente maladive, pour reprendre l’expression utilisée par le journaliste cité. Les printemps ne sont pas que le temps de l’éclosion des bourgeons et des fleurs. Ils sont aussi traversés par des giboulées et des vents de sables violents et redoutables et même des retours de l’hiver… Voilà ce que vit actuellement le pays. Si l’on parle de la « différence algérienne », ce n’est pas une pure figure littéraire !
Et l’Eglise dans ce printemps ? C’est un point qu’il est important de cerner dans ce contexte, et qui nous concerne, nous chrétiens, en premier lieu ! Elle aussi a payé au prix fort les violences de la décennie noire, en s’inscrivant librement dans les risques à courir à la suite de son choix : rester ! Les évêques avaient affirmé que l’Eglise ne quitterait pas le pays, et elle en a accepté les conséquences, en solidarité avec la population. Il faut le dire : elle n’a pu demeurer dans cette tourmente que grâce à cette population elle-même, aux amis et aux proches qui « veillaient » attentivement sur elle. Elle n’aurait pas pu tenir si elle n’avait été soutenue par tant de solidarités. Et elle a continué à s’inscrire modestement dans le fil des événements. Depuis la fin des années 90 et le début du nouveau millénaire, marqués par un processus de réconciliation nationale, elle a pu, elle aussi, reprendre souffle. Mais la voici traversée par de nombreux changements qui lui font faire le passage à une nouvelle étape, changements qui ont pu prendre de court la génération précédente. C’est d’abord l’arrivée d’une nouvelle vague de permanents et de permanentes - religieux, religieuses, prêtres et laïcs - , mais aussi de nombreux étudiants et étudiantes subsahariens venus faire leurs études universitaires dans le pays, et cela pour plusieurs années. L’Eglise a changé et s’est renouvelée. Jusqu’ici, les «vocations » venaient surtout de France ou au moins d’Europe. Elle a pris un visage plus universel : la majorité de la « nouvelle génération » de permanents vient surtout de l’Afrique subsaharienne, voire même de l’Asie et de l’Amérique du Sud. Cette nouvelle génération n’a pas connu les années de tourmente et se situe dans une optique différente. Elle est moins marquée par le Concile de Vatican II, dotée d’une sensibilité autre, revendiquant une plus grande « visibilité », affranchie de tout complexe « postcolonial », le pays d’origine de ces nouveaux arrivants ayant été souvent colonisé ! Elle ne fait pas pour autant table rase du passé et de l’attitude de fond qui marque notre présence : le respect de la culture, de l’Islam et des musulmans, et l’option où le témoignage de la vie parle plus que la parole elle-même. Dans les changements notoires qui ont marqué le début des années 2000, il faut aussi noter un courant d’origine évangélique, notamment dans la région de Kabylie, mais pas exclusivement dans cette contrée. Ce courant s’est concrétisé par l’apparition de nombreuses communautés évangéliques regroupées pour la plupart dans l’Association des Eglises Protestantes d’Algérie (EPA), Association reconnue depuis plusieurs années. Ce phénomène est nouveau, presque inédit dans le monde arabe, vu la conversion à la foi chrétienne de croyants musulmans, et la Constitution algérienne garantit la liberté de conscience et de culte (bien sûr sous des conditions édictées par la loi). Cela n’est pas sans conséquence pour l’Eglise catholique qui accueille elle aussi des croyants du pays, même si cela reste exceptionnel. Tout ne se déroule pas sans tiraillements ni sans problèmes, elle en subit quelques inévitables retombées. Suspectée parfois de prosélytisme, elle doit en assumer les conséquences inhérentes à sa propre vocation. Mais il est clair qu’en aucun cas elle ne saurait faire pression sur qui que ce soit pour rejoindre ses rangs ! Cela ne fait-il pas partie de la liberté de conscience reconnue à toute personne, ce qui peut engendrer de part et d’autres des souffrances compréhensibles. Mais elles ne peuvent entamer la confiance mutuelle et une amitié née et renforcée dans les dédales d’une histoire parfois douloureuse, mais toujours marquée par une forte amitié et un « respect têtu » ! Avec le pays tout entier, les chrétiens de ce pays, qu’ils soient étrangers ou issus de cette terre où Augustin a vu le jour, partagent la même espérance d’un printemps encore en phase évolutive, où, nous le souhaitons, les fleurs seront le signe de fruits prometteurs ! +Claude
Rault, |


| EPISODE
1 A Ghardaïa, rencontre avec les Pères blancs et les Sœurs blanches A 600 km au sud d’Alger, la ville de Ghardaïa domine la vallée vallée désertique du Mzab. Là, les Pères blancs - communauté de prêtres fondée en 1872 par le cardinal Lavigerie – animent un centre culturel que fréquentent Mozabites chiites et Arabes sunnites. L’un des rares lieux de rencontre des deux populations.  Père Louis Lucet - Toit du Centre culturel et de documentation saharienne - Ghardaïa "Notre vocation : être ce que l’on est, des chrétiens au milieu d’une population très différente." Père Louis Lucet, dit Ludo, supérieur des Pères blancs de Ghardaïa |
CLIQUEZ ICI POUR
ÉCOUTER (chargement long en format M4a) Le centre culturel, dirigé par le Père Krzysztof Stolarski, possède un fonds de 18 000 documents, dont 11 000 livres spécialisés sur le Sahara. En plus d’œuvrer pour la protection du patrimoine local, les Pères Blancs donnent des cours de français, d’anglais ou d’allemand.  Soeurs blanches Une façon aussi d’apporter aux habitants du Mzab la réalité étrangère et chrétienne et par là-même de leur faire redécouvrir leur propre identité. Les Pères blancs affirment volontiers être un pont entre les cultures. "Dans cette région, on n’a pas peur de se dire croyant ; le sens de Dieu est très présent." Père Louis Lucet |