
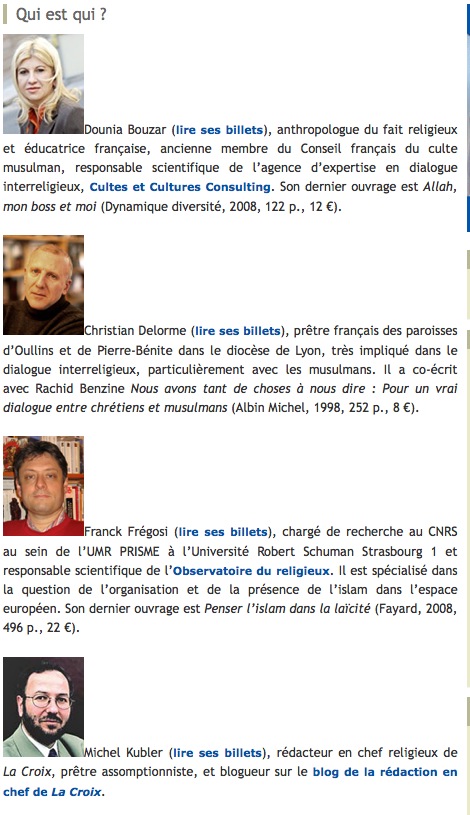
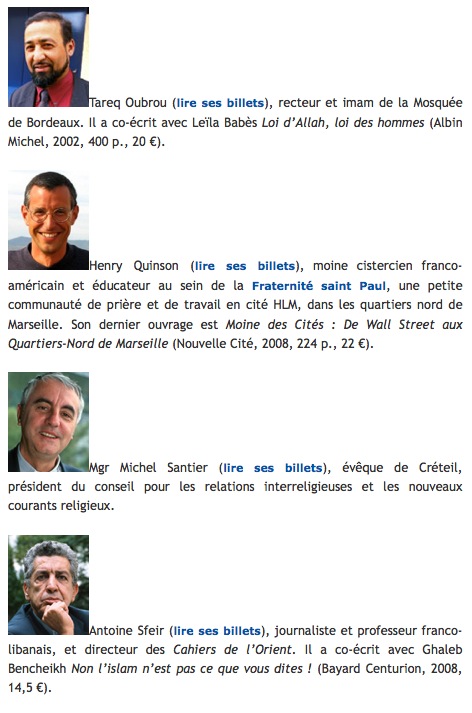
cliquez sur le lien (titre en bleu e& photo ci-dessouscouleur bleue souligné) pour accéder au blog de chacun des intervenants
| Mardi 14 octobre 2008 Dieu ne réside pas dans une cloche à fromage  Henry Quinson Une citation concernant l’islam dans une longue allocution du pape Benoît XVI à l’université de Ratisbonne le 12 septembre 2006 provoqua, dans le monde musulman, des réactions enflammées. Certains s’en étonnèrent, d’autres en furent alarmés, d’autres encore consternés ou blessés. Comment un discours dont la teneur était avant tout théologique peut-il susciter des actes de violence dans la rue ? Qui, parmi les manifestants, avait lu l’intégralité du texte du pape ? S’agit-il là de réactions purement confessionnelles à un propos théologique ? Y a-t-il eu manipulation ? Comment intéresse-t-on soudain les foules à des réflexions religieuses intellectuellement aussi exigeantes ? Paradoxalement, le discours du pape et ces réactions populaires ont permis de relancer ce que l’on appelle le « dialogue interreligieux » avec certains savants musulmans à la suite d’un appel de 138 personnalités se réclamant de l’islam. Mais cet épisode a clairement montré qu’une réflexion sur « foi et raison » destinée à des professeurs d’université en Allemagne pouvait aujourd’hui déchaîner les passions de la foule dans une autre partie du globe. Dans ces conditions, un dialogue théologique serein entre chrétiens et musulmans est-il possible ? L’incident de Ratisbonne ne souligne-t-il pas que parler de « religion » en pays musulman ou en Europe renvoie à des réalités qui ne sont pas exclusivement confessionnelles ? Pour un Français qui a connu l’Algérie comme appelé du contingent entre 1954 et 1962, l’islam peut, consciemment ou inconsciemment, rappeler un temps de guerre, pourtant commandé par des objectifs politiques et non religieux. De même, un Algérien comme Ali Belhadj (ex numéro 2 du Front islamique du salut) n’a pas oublié que son père fut tué par l’armée française. Il n’est pas seul dans ce cas. Pour un New-yorkais comme moi, l’islam pourrait se résumer au 11 septembre 2001. L’un de mes cousins a perdu plusieurs de ses collègues ce jour-là. La liste des mauvais souvenirs est longue, de part et d’autre : djihads, croisades, conflit palestinien, révolution iranienne, guerres en Irak, colonisation, décolonisation, racisme, pauvreté, oppositions Nord-Sud, dictatures, pétrodollars et cartels, immigration et « banlieues ». Nous pouvons le regretter, mais l’identité religieuse d’espaces culturels, socio-politiques et économiques est (plus ou moins selon les personnes) associée à tous ces événements. Difficile, dans ces conditions, d’isoler le débat théologique dans une cloche à fromage où Dieu ne toucherait plus terre ! Pour les Français qui habitent les quartiers populaires de nos villes, les musulmans sont souvent des étrangers et des pauvres. Pour le chrétien français qui, comme moi, habite une cité HLM, se mêlent donc des questions différentes, qu’il faudrait en théorie distinguer, mais qui en réalité sont indissolublement liées. Accueillir les familles étrangères fraîchement débarquées de l’autre côté de la Méditerranée relève de la « pastorale des migrants ». Aider à la réussite scolaire et à l’insertion économique procède de la « doctrine sociale » de l’Eglise. Mais si l’étranger pauvre est aussi musulman, la théologie de Vatican II nous invite à pratiquer le « dialogue interreligieux ». La combinaison de ces trois dimensions, culturelle, sociale et religieuse, rend le dialogue particulièrement complexe pour ceux qui vivent dans les quartiers déshérités de nos villes. Comment dialoguer lorsque manque une langue commune suffisamment maîtrisée ? Quand les mots sont des murs, il convient d’abord de les transformer en fenêtres. Le plus souvent, c’est la deuxième génération qui saura trouver les ressources linguistiques et culturelles pour dialoguer, grâce à l’école notamment. Le dialogue des peuples exige donc une grande patience et un vrai travail. Pour les chrétiens, Dieu a mis des siècles avant de se faire l’un de nous, et il a mis trente ans avant de parler en notre langage d’hommes. Il serait dérisoire de vouloir cueillir les fruits d’un dialogue sans d’abord vivre ensemble et apprendre une langue commune. Ceci est d’autant plus vrai que nous avons souvent peur les uns des autres. Les hommes avaient peur de Dieu. Pour se faire entendre, Dieu est venu habiter avec nous dans l’humilité. Il a commencé dans le silence de l’apprentissage et de l’écoute. Pouvons-nous faire l’économie de ce voisinage dans la durée et la proximité avec nos frères musulmans ? En France, nombreux sont les quartiers où cette vie ensemble est possible. Le dialogue interreligieux commence par la rencontre interculturelle, la justice sociale et des gestes de réconciliation. Comment parler de nos représentations de la vie et de la mort, de notre identité religieuse, sans d’abord devenir frères et sœurs dans la vie courante ? Les cages d’escaliers de nos cités HLM sont au moins aussi importantes que les couloirs du Vatican. Henry Quinson posté par * |
Mardi 14 octobre 2008 Les religions évoluent par l’expérimentation humaine partagée  Le meilleur service à leur rendre, c’est de considérer les musulmans comme des gens comme les autres. Cela veut dire que, pour les musulmans aussi, l’histoire que l’on se fait de sa religion dépend de sa propre histoire. Et il faudrait se rappeler que l’on ne rencontre jamais « des religions » ou « des cultures » mais toujours des individus qui s’approprient différents éléments de culture et de religion pour se construire, toujours en interaction les uns avec les autres. Les musulmans ne sont pas que le produit de leur islam. Ils sont aussi le produit d’un niveau économique, culturel, intellectuel, de leur histoire familiale, du quartier où ils habitent, des amis qu’ils ont rencontrés, etc. De nombreux discours musulmans voudraient réduire ces croyants à leur dimension religieuse avec un islam présenté comme un système social et global, qui définirait et déterminerait les personnalités dans tous les domaines de leur vie. Ce qui apparaît dramatique, c’est que certains discours institutionnels et politiques partent des mêmes postulats : - l’islam apparaît comme un concept abstrait, uniforme, déterminé une fois pour toutes, quels que soient les lieux et les époques ; - il existerait une personnalité islamique de base qui aurait des particularités permanentes. En appréhendant l’islam comme une « essence englobante », certains discours politiques, à l’instar de certains discours religieux, prive la réflexion de données anthropologiques et historiques et l’enferme dans le registre de l’idéologie. Pourtant, une chose est sûre : il n’y a pas de définitions toutes prêtes pour expliquer « comment être musulman dans cette société pluraliste et laïque ». Nous sommes dans un tournant historique où les jeunes nés ici ne peuvent plus regarder à l’étranger pour trouver des réponses à leurs questions. Ce contexte français pourrait permettre l’émergence d’une nouvelle religiosité musulmane en fonction de trois paramètres principaux : - les musulmans ne sont plus dans une culture de type clanique (dans laquelle le clan définit la place et la conduite de la personne) mais ont appris à dire « je » ; - le contexte démocratique garantit le libre échange ; - la laïcité issue de l’histoire de France, le contexte de pluralisme démocratique laïc oblige ainsi les musulmans, comme cela a été jadis le cas pour les autres croyants, à réorganiser leur manière d’exister et de croire, à partir de cette nouvelle expérience. Toutes les occasions sont requises pour que, de façon massive, des musulmans réfléchissent à la question : Où et comment faire la séparation entre le profane et le sacré ? Comment faire la différence entre les principes religieux et les formes historiques que ces derniers ont pris au fil des siècles dans les différentes sociétés musulmanes ? Les chrétiens ont mis plus d’un siècle à faire ce travail. La démarche n’est pas facile pour les musulmans en si peu de temps. Je pense qu’il y a deux conditions pour que cette nouvelle religiosité émerge. Premièrement, admettre l’existence d’une interaction entre le contenu du message divin et sa réception par les êtres humains, et donc accepter de prendre en compte les variables extra-religieuses dans l’interprétation du texte sacré : « La vieille paysanne égyptienne qui a passé sa vie dans sa cuisine ne comprend pas la même chose de son Coran que l’avocate qui exerce en plein centre de New York». Cela signifie qu’on admet que les normes émanent aussi des processus sociaux et historiques. Et là apparaît la deuxième condition : l’historicité. Pour déconstruire des normes ancestrales, un seul moyen : accepter de faire la distinction entre credo et histoire. Ne pas confondre le texte divin et sa compréhension dans une culture donnée. Le texte est divin mais les interprétations sont humaines, et toute interprétation provient d’une expérience au monde. La relation au texte change aussi selon la relation aux autres : lorsque, dès l’école maternelle, je grandis avec Elisabeth qui ne croit pas en Dieu, Marie qui est chrétienne, Jean-Paul protestant et David juif, la « transpiration humaine » avec ces enfants fait lien et je m’enrichis de leurs visions du monde. « L’agir humain partagé » amène à appréhender mon texte religieux sous de nouveaux angles de compréhension. Les différentes visions du monde ne constituent plus un danger mais une richesse : il n’y a plus de concurrence, au contraire, je peux m’enrichir de tout ce qui m’entoure - êtres humains différents et autres visions du monde – pour agrandir et affiner ma perception du message divin, à partir de ce que je suis aujourd’hui ici maintenant. Ce mélange humain influe aussi sur la conception de « la vérité » : Le texte sacré n’est pas ouvert pour y chercher « la Vérité », il n’est pas utilisé comme un « mode d’emploi ». Il révèle son sens dans le dialogue avec les êtres humains qui, eux-mêmes, s’enrichissent du reste du monde. Du coup, les textes sacrés ne font pas séparation avec les autres vivants (c’est à dire qu’il ne faut pas passer par le texte pour avoir accès à « la Vérité »). Au contraire, les autres vivants (non musulmans et non croyants) et les autres visions du monde sont une aide pour agrandir la compréhension du message divin. Les jeunes nés en France se retrouvent dans des nouvelles situations concrètes créées par le vécu dans le pluralisme laïc et la modernité. Les jeunes femmes ont massivement accès au savoir et au travail. Les anciennes interprétations ne donnent plus toujours de sens à ces nouvelles situations concrètes. Le « faire » des hommes interroge certaines interprétations et provoquent de nouvelles significations. Le problème, c’est que dans les débats publics, l’islam continue à être présenté comme un cas à part qui se distinguerait précisément par le fait que religion et politique y seraient indissociables. Hommes politiques et islamistes énoncent d’une même voix, reprise en écho par les médias, qu’il n’existe aucune distinction entre l’instance spirituelle et l’ordre temporel en islam. Cette façon de prétendre que le christianisme, à l’inverse de l’islam, est intrinsèquement laïc, évacue toute la dimension historique des déclinaisons des deux religions. Il est donc fondamental de réaliser que ce type de discours institution-politique-médias reprend le lexique religieux des prédicateurs islamistes, ceux-là mêmes qui veulent détenir le pouvoir par le monopole de la production de symbolique religieuse et faire croire que la seule façon de rester fidèle consiste à rester enfermés dans une pensée médiévale. Pour que les musulmans de France réfléchissent à « une nouvelle façon d’être musulman », il est fondamental que la laïcité leur garantisse leur liberté de conscience et de culte, pour que les expérimentations puissent se faire. Ma phrase de fin se présente sous forme de question : qu’est-ce qui fait lien entre tous les Français ? Est-ce qu’on se ressemble d’abord parce qu’on a un vécu commun ou d’abord parce qu’on a la même religion ? Les religions n’évoluent pas par des grandes théories mais par l’expérimentation humaine partagée. Merci aux autres croyants de s’en rappeler. Dounia Bouzar  |
| Mardi 14 octobre 2008 Musulmans en France, musulmans de France : pour une sociologie de l’islam en France  Avant la tenue à Rome du premier forum catholiques musulmans (du 4 au 6 novembre), il convient de s’intéresser à l’état du dialogue islamo-chrétien dans l’hexagone. Un important préalable à ce bilan consiste à s’interroger sur les contours de cet islam de France. De quoi parlons-nous ? Qui sont ces musulmans ? Voilà un court texte qui s’efforce de donner quelques éléments de réponse. De nos jours, la population musulmane en France représente très approximativement entre trois et quatre millions de personnes. Il s’agit pour la plupart d’étrangers (123 nationalités), de descendants français de populations immigrées venues principalement du Maghreb, de Turquie, d’Afrique sub-saharienne, du Moyen-Orient, d’Asie, et dans une moindre mesure de Français convertis à l’islam. Ces populations, majoritairement issues de sociétés dont l’islam est de jure ou de facto la religion dominante n’ont pas de l’islam la même perception. Pas plus qu’ils n’observent de façon rigoureuse tous ses préceptes religieux (cinq prières quotidiennes, interdits alimentaires, jeûne du mois de Ramadan, règles vestimentaires…), ils ne sont d’accord sur le contenu de ce que recouvre l’islam. Une étude de l’IFOP pour le journal La Croix réalisée en décembre 2007 auprès d’un échantillon de 537 personnes issues d’une famille musulmane et habitant en France nous montre que 33% des personnes interrogées sont des musulmans croyants pratiquants, 38% des musulmans simplement croyants, 25% se définissent comme d’origine ou de culture musulmane, enfin 1% aurait opté pour une autre religion et 3 % auraient renoncé à toute religion. On est donc là face à au moins quatre types différents d’islamité : un islam pieux qui se manifeste par une pratique exigeante, un islam plus spirituel qui se résume souvent à une croyance déconnectée d’une pratique, un islam culturel fruit d’un héritage familial et enfin un islam récusé. Si depuis une dizaine d’années on observe une progression régulière des indicateurs de religiosité comme la prière quotidienne (39 %), la fréquentation des mosquées (23%) notamment parmi les jeunes, certaines pratiques comme l’observance du jeûne doit davantage être considérée comme un comportement et un réflexe culturel que l’expression d’une religiosité forte. C’est ainsi que 70 % des musulmans déclarent pratiquer le jeûne. Pratiquants réguliers, croyants non pratiquants comme simples personnes d’origine musulmane restent attachés à la pratique du jeûne de Ramadan. C’est l’occasion de renforcer la convivialité (repas de rupture de jeûne le soir, visite des voisins) et l’esprit de solidarité (ouverture aux plus démunis). C’est le versant festif de l’islam qui remporte le plus d’adhésion parmi les musulmans. En ce qui concerne la consommation d’alcool, un tiers des musulmans déclare en consommer sans pour autant cesser de se considérer comme musulmans. Aux clivages liés à l’intensité de la pratique s’ajoutent les clivages ethniques (Maghrébins, Tucs, Africains, Asiatiques), linguistiques (arabophones, berbérophones, turcophones, kurdophones…), générationnels (primo-migrants, jeunes) et religieux (islam traditionaliste, islam réformiste, islam littéraliste, islam mystique…). Franck Frégosi |
Mardi 14 octobre 2008 Un islam si familier qu’il fait partie de ce que je suis  Il y a 35 ans que, au hasard des rencontres, des musulmans de Lyon sont entrés dans ma vie et ne l’ont plus quittée. De ce fait, leur islam, leur manière de vivre leur foi, n’a cessé de m’accompagner et fait partie de ma propre existence. Une famille d’origine algérienne, tout particulièrement, est devenue pour moi une deuxième famille. Pour la maman maintenant largement octogénaire, je suis un fils. Pour ses enfants (ils sont onze , six garçons et cinq filles) : un frère. Et pour les enfants nés de ceux-ci : un oncle ou un parrain, quand ce n’est pas un “deuxième père” (Heidi, 25 ans 1/2, auquel me lie une relation très étroite depuis sa naissance, est vraiment pour moi un fils). Avec cette famille, mais avec plusieurs autres aussi, à Lyon et au-delà, j’ai partagé, tout au long de ces années, mille et une choses qui font la vie des gens : joies et peines, mariages et divorces, naissances et deuils. Depuis 35 ans, je célèbre avec tous ces amis ou parents musulmans les grandes fêtes de l’Aïd el-Fitr et de l’Aïd el-Ada qui ne sont en rien contraires à la foi chrétienne, et je m’unis, en restant à ma place de chrétien, à ce grand événement annuel que représente chaque mois de Ramadan. Cet islam familial m’est si familier qu’il ne m’est plus “étranger” depuis longtemps et fait partie de ce que je suis. Je goûte avec bonheur ses points de rencontre avec ma foi chrétienne, et j’accueille comme une épreuve mystérieuse ce qui, en lui, se présente comme refus radical de la spécificité chrétienne. Mes amis (mes parents musulmans) me perçoivent sans doute comme un “demi-musulman”, un disciple de Jésus à qui manque la pleine confession de foi musulmane, mais un ami de Dieu néanmoins, un ami des croyants en tout cas. Pour moi, évidemment, les discours, venus de chrétiens ou de musulmans, selon lesquels nous n’aurions pas “le même Dieu”, constituent un scandale, car je sais que c’est bien dans le même Seigneur de l’Univers que mon “fils” Heidi et moi, ou mon ami Rachid Benzine et moi, nous mettons notre confiance. Christian Delorme |
| Mardi 14 octobre 2008 Ni miroir, ni repoussoir  Comment trouver le juste registre pour se rapporter à l’islam, quand on est chrétien d’Occident ? De multiples pièges se tendent en effet, et parfois se conjuguent, pour fausser notre regard ou biaiser notre discours. Nous n’en sommes pas forcément conscients, mais ils sont à tous les coups perçus par les musulmans. Deux de ces pièges me semblent particulièrement redoutables à l’heure actuelle : - traiter l’islam comme un repoussoir : on veut le diaboliser, en proportion directe d’une valorisation recherchée pour le christianisme. Comme si ma propre foi devait se nourrir d’une supériorité par rapport à celle de l’autre. Comme si je devais en permanence me convaincre que ma confession est “meilleure” en la comparant à l’autre : une foi plus pure, un degré de révélation supérieur, une antériorité dans la révélation… - se servir de l’islam comme d’un miroir : cette posture est encore pire, mais plus sournoise. Elle fait tout voir en rigoureuse opposition : l’islam devient alors l’envers exact du christianisme, en parfaite incompatibilité bien sûr. Il est réputé intrinsèquement pervers, comportant en sa nature tous les excès que certains de ses adeptes peuvent commettre - là où le christianisme, bien sûr, est totalement pur en soi et à peine affecté par le péché des fils de l’Église ! Ces deux attitudes ont en commun un grave défaut : elles instrumentalisent l’autre religion, et donc manquent absolument de respect à son égard, empêchant de porter sur elle un regard qui la considère pour ce qu’elle est. Et elles procèdent fondamentalement d’un même mouvement : la peur, par manque de confiance en soi. Un seul remède : partir résolument à la rencontre de l’autre tel qu’il est, s’enquérir de ce qu’il croit sans immédiatement le rapporter à mes propres convictions, prendre acte honnêtement de ce que sa foi opère en lui, et dans sa vie. Car inutile de dire, par ailleurs, que le mot “dialogue” n’a aucun sens en de telles postures de miroir ou de repoussoir… Comment échanger en vérité, si l’un des partenaire (voire les deux !) retient toujours ce que sa tradition a de meilleur, pour l’opposer à ce que l’autre comporte de pire ? Michel Kubler |
Jeudi 16 octobre 2008 Le dialogue, un devoir éthique et une nécessité existentielle   Trois raisons me paraissent fondamentales pour s’engager dans le dialogue islamo-chrétien. Tout d’abord une raison tout à fait naturelle : la curiosité de rencontrer celui qui est différent, mais qui paradoxalement me ressemble par certains aspects. Nous sommes tous, en définitive, des humains appartenant à une grande et même famille. Mais nous sommes différents ethniquement, linguistiquement, religieusement… Une raison pour se rencontrer. «Nous vous avons créé à partir d’un homme et d’une femme et Nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez mutuellement…», nous confirme le Coran. Deuxième raison, nous partageons avec les chrétiens la foi en un Dieu Unique. Nous croyons au même Dieu, même si nous n’en avons pas exactement la même perception. Au-delà de nos différences nous sommes appelés à nous unir autour de Lui : « O vous Gens du Livre ! Venez tous à une parole commune entre nous … ». Dans ce dialogue et cette rencontre, il faut mettre en relief ce qui nous unit, certes, mais également ce qui nous différencie sans méprise, ni offense. « Ne dialoguer avec les gens du Livre que par la meilleure façon », nous rappelle le Coran. Le qualificatif « Gens du Livre » englobe ici tous ceux qui adhèrent à un monothéisme révélé, mais les chrétiens ont une place particulière dans le Coran : « Et tu trouveras parmi les chrétiens ceux qui sont les plus proches des croyants -ici les musulmans-», nous dit-il. Troisième raison : c’est que l’islam et le christianisme sont des religions fortement missionnaires. Par conséquent, elles ont intérêt à ne pas transformer leur universalisme en une compétition et un combat agressifs qui porteraient préjudice aux valeurs qu’elles prônent. Nous avons donc, chrétiens et musulmans, le devoir de nous rencontrer et de nous entendre notamment à un moment de notre histoire très fragile, marquée par l’incertitude et l’inquiétude. Par conséquent ces deux religions doivent rassurer les hommes et donner espérance pour une vie meilleure, plus juste, plus égalitaire. Au lieu d’un conflit interreligieux idiot, nous devons combattre main dans la main l’angoisse qui pèse sur l’avenir de l’humanité et répandre la miséricorde. Et je suis convaincu que l’islam et le christianisme ont tous deux ce potentiel de générosité et de charité d’ordre universel qui leur confère ce statut de religions de paix, et de salut d’abord dans l’ici-bas. C’est pour ces trois raisons que le dialogue islamo-chrétien me paraît un devoir éthique et une nécessité existentielle. Tareq Oubrou |
| Jeudi 16 octobre 2008 Le dialogue pour sortir de la méfiance et de la peur  Le dialogue entre musulmans et chrétiens n’est aisé ni pour eux, ni pour nous, dans la situation actuelle. Il est nécessaire pour sortir de la méfiance et de la peur de faire des distinctions entre islam et islamistes. L’islam est une religion, l’islamisme est une idéologie politique qui appelle à la violence au nom de Dieu, ce qui est inacceptable et refusé par un grand nombre de musulmans dans notre pays. Le dialogue n’est pas à établir entre islam et christianisme comme s’il s’agissait de deux blocs, comme l’Occident et le Moyen-Orient. Les catholiques sont présents dans le monde entier comme les chrétiens, et les musulmans sont présents dans de nombreux pays bien au-delà du Moyen-Orient et des pays du Maghreb. Le dialogue et la rencontre sont à vivre au quotidien entre chrétiens et musulmans. Si ce dialogue de la vie qui se met déjà en place se poursuit malgré les obstacles, petit à petit, les méfiances, les peurs, les fausses images mutuelles, les incompréhensions s’estomperont. Le dialogue est indispensable pour que nous puissions vivre ensemble, et que la Paix s’installe durablement dans la relation entre les peuples. Le dialogue peut conduire à des actions communes au service de la paix, pour le respect des droits des plus pauvres, des immigrés. Le dialogue au plan théologique est plus délicat, car sous les mêmes mots nous ne mettons pas la même signification à cause de nos différences culturelles et notre conception différente de Dieu. Le dialogue comme partage de notre expérience spirituelle de croyants est possible, souvent riche ; découvrir chez l’autre la profondeur de sa relation à Dieu et aux autres permet de changer de regard sur ceux qui croient différemment de nous. Le dialogue n’est pas du relativisme. Cela suppose que chacun puisse être écouté, demeure enraciné dans sa foi ; ceux qui pratiquent le dialogue disent que cela les a fait grandir dans leur propre foi. Le dialogue doit se poursuivre quelles que soient les difficultés qui se présenteront. Il connaîtra des temps de recul, des temps d’avancée. Le dialogue entre chrétiens et musulmans, dialogue exigeant, est un passage obligé pour que notre pays, le monde, vivent dans la paix. C’est un don à demander à Dieu dans la prière. Mgr Michel Santier |
Jeudi 16 octobre 2008 Un dialogue irréaliste ?  Parler du dialogue islamo-chrétien relève à l’aune de l’histoire, en tout cas celle du Proche-Orient, d’un irréalisme étant donné que les deux religions ont vécu dans une entente quasi-parfaite non seulement au XXe siècle, mais durant les 400 ans de la tutelle de l’Empire ottoman. Que ce soit dans les montagnes libanaises ou sur les rivages syriens, que ce soit sur les bords du Nil ou dans les contreforts jordaniens – avant même l’existence de la Jordanie –, il y avait non seulement une coexistence, mais un « vouloir-vivre-ensemble ». Cela se traduisait dans un même village parfois par des réunions communes dans leur lieu de culte respectif. Cela s’illustrait également par des prises de position communes concernant la ville ou le village. Que s’est-il donc passé pour qu’aujourd’hui nous nous contentions de la coexistence ou d’une simple cohabitation ? Il est un fait que le dialogue existant ne se limitait en aucun cas au seul fait religieux ; ce dernier faisait partie de la vie et le dialogue s’articulait autour de la vie de tous les jours. Durant le jeûne du Ramadan, les populations chrétiennes se gardaient bien d’étaler leurs couverts et se faisaient discrets ; il en était de même pour les populations musulmanes lors du Carême. Lors du mois marial de mai, la statue de la Vierge passait de maison en maison : il était alors impensable qu’elle ne s’arrête pas dans les maisons musulmanes. Sans doute la colonisation a-t-elle voulu jouer les communautés les unes contre les autres, et au fil des ans et des décennies, les communautés se sont renfermées sur elles-mêmes. Cela a impliqué de plus en plus la méconnaissance de l’autre. N’a-t-on pas peur de tout ce qu’on ignore. L’intervention américaine en force dans la région en ce début du XXIe siècle a sans aucun doute accentué ce renfermement communautaire. On ne connaissait plus l’autre. On ne pourrait le reconnaître dans son altérité tel qu’en lui-même. On se contente de cohabiter avec lui, on le tolère avec tout ce que ce terme peut charrier de condescendance vis-à-vis de l’autre. En effet, comment peut-on reconnaître l’autre quand on ne fait pas l’effort de le connaître ? Antoine Sfeir |





***************************************************************************
Amis du Diocèse du Sahara
(ADS)Accueil