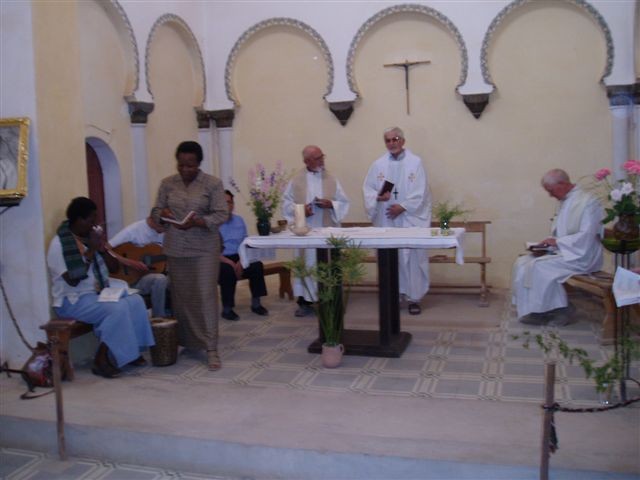La
vie économique et sociale de notre monde saharien
Je ne veux me situer ni en sociologue ni en économiste,
mais avec le regard d’un pasteur, d’un disciple de Jésus qui
ne peut être étranger à tout ce qui est de
l’humanité concrète où nous sommes plongés.
J’aimerais que mon regard ne soit pas dénué d’objectivité,
mais qu’il soit le plus évangélique possible.
Comment Jésus, comment l’Eglise naissante regardaient-ils
leur monde ? Quel enracinement humain avaient-ils opéré
au cœur de ce monde où ils vivaient ? C’est bien à partir
de ce regard qu’ils ont initié et fait grandir le Royaume de Dieu.
Comment je vois donc ce monde, cette Société où
nous sommes engagés
|
Une population qui s’est diversifiée
Cette population peut s’évaluer à environ 3.500.000
habitants. La plus grande partie se situe au nord Sahara, spécialement
en son centre (axe Djelfa, Laghouat et Ghardaia, à l’ouest (El
Bayadh et ses environs), à l’est (El Oued, Touggourt, Ouargla).
Les villes du grand sud se développent aussi : Tamanrasset
(100.000 ha), Adrar, Béchar.
La zone de pauvreté la plus criante est la région
Nord Ouest du Diocèse. C’est sans doute là que nous sommes
les plus fragiles et les moins présents.
Cette population s’est diversifiée depuis ces dernières
années : les années 90 avec les violences que l’on connaît
ont vu affluer du Nord une population qui a cherché refuge dans
cette vaste région jugée un peu plus calme.
Nos Oasis sont donc constituées de populations plus " mêlées
", les habitants d’origine ne voyant pas toujours d’un bon œil ces nouveaux
venus affluer, prendre souvent des postes de travail dont ils sont privés,
et venant grossir les villes déjà en mal de croissance.
Il s’en suit que le caractère spécifique de ces
oasis a subi un sérieux coup. Que dire d’une ville comme Tamanrasset,
réputée pour être ville de refuge ou d’accueil de
populations venues de Kabylie, des Hauts Plateaux, et aussi ville de transit
pour les Subsahariens dans leur transhumance vers les pays d’Europe ?
Globalement, la population d’origine ne s’est pas encore
effritée dans ses structures traditionnelles, la famille n’a pas
trop éclaté, comparativement aux villes du Nord. La famille
élargie reste un pôle de référence et de solidarité.
Il n’en est pas de même pour la population récemment arrivée,
elle a perdu ces points de référence et subit une évolution
plus brutale, et est plus fragilisée, voire même " paupérisée
", manquant de cette solidarité qui constitue, comme l’on dit,
la sécurité sociale des pauvres.
Nous assistons donc à un désenclavement du Sahara,
et par le Nord, et un peu par le Sud, à une diversification de
la population de plus en plus grande. Le mélange s’est fait sous
la poussée des années " noires " et sur les contraintes économiques
qui amènent les jeunes et les moins jeunes à chercher du
travail là où il y a plus de chance à en trouver.

|
Une économie
" tiraillée " entre abondance de richesses et manque de travail
N’oublions pas que les plus grandes richesses du pays se trouvent
au Sahara. Le pétrole et le gaz représentent
plus de 90% des revenus du pays. La rente pétrolière de
l’année passée est évaluée, selon des chiffres
glanés dans la presse, à plus de 50 milliards de dollars,
avec le prix du baril qui navigue autour de 60 $. L’Algérie rembourse
sa dette. Elle fait aussi bénéficier le pays de cette manne
en bien d’équipement : projet de 1.000.000 de logements d’ici 2010,
entretien des routes, assainissement hydraulique des villes, soin apporté
à l’équipement urbain, etc.
Mais l’apport financier n’est pas ou peu créateur d’emplois.
Le chômage continue de drainer une population assez jeune et peu
préparée à intervenir sur les champs de pétrole
et dans l’industrie pétrolière. Les responsables économiques
sont tiraillés par les lois du marché, et préfèrent
souvent une main d’œuvre étrangère plus facile à
canaliser, et parfois plus rentable et mieux formée. Ceci entraîne
la protestation de la population locale, et nous avons déjà
assisté à des soulèvements locaux occasionnés
par des emplois revenus soit à des expatriés, soit à
des gens venus du nord, là où sont les décideurs économiques.
La presse en a fait état.
Plusieurs grands projets sont en voie de réalisation dans
le Sahara :
- l’assainissement des eaux usées (qui représente
parfois des projets énormes, pensons à Ouargla),
- l’acheminement de l’eau potable à Tamanrasset à
partir d’In Salah,
- le chemin de fer de l’ouest, qui pourra relier Oran à
Béchar,
- l’entretien du réseau routier, qui représente
plusieurs milliers de km de routes.
- le soutien au développement agricole, grâce à
des subventions accordées à de nouveaux projets.
- des projets de construction de logements, comme dans l’ensemble
du pays. Et tout récemment signalons un plan de développement
de la région des Hauts Plateaux, dont a fait écho la radio
et les journaux.
Une autre source de revenus, mais plus intérieure à
l’économie de la région, c’est la relance de l’agriculture.
Nous constatons de beaux projets, de belles réalisations, mais
aussi des échecs faute d’un suivi assidu. L’Etat intervient généreusement
pour une aide à de nouveaux projets agricoles, mais dont la supervision
est difficile à suivre.
Par contre, l’évolution du pastoralisme va dans un autre
sens. Il est vrai que les pluies ces dernières années
ont été assez généreuses pour le nord Sahara
et les Hauts Plateaux, mais l’avance du désert continue. Les
années sombres de la dernière décennie ont vu la
diminution, voire même la disparition du pastoralisme familial,
au profit du grand pastoralisme. De moins en moins de tentes apparaissent
dans l’espace saharien. Les gros troupeaux sont de plus en plus fréquents,
transportés par des camions qui servent aussi à les alimenter
en eau. Ils ne sont plus gardés par des familles, mais par des bergers
à gage, et appartiennent à de gros propriétaires.
Cette évolution est due aussi au désir des familles
de se rapprocher des centres urbains afin de permettre aux enfants d’être
scolarisés. Ceci entraîne bien sûr un éclatement
urbain, et ne donne pas pour autant la possibilité aux familles
de vivre de façon décente.
Parlons du commerce. Sans doute n’avons-nous jamais vu
autant de commerces se développer dans nos cités sahariennes.
Des magasins s’ouvrent, proposant des marchandises qui vont de l’ordinateur
dernier cri (venant souvent de Chine) aux fripes, qui font le bonheur des
familles souvent nombreuses qui ont la possibilité de s’habiller
à moindre frais. Mais cela va sans doute obliger de remettre à
jour les petits centres de " coupe - couture ", et à revoir de nouveaux
champs pour la promotion féminine.
Le tourisme reste marginal. Il y a une nette reprise, notamment
au Hoggar, qui n’est pas seulement due à la béatification
de Charles de Foucauld, mais au retour de la sécurité. Il
profite essentiellement aux compagnies aériennes, et aussi aux multiples
agences de tourisme de Djanet et de Tamanrasset. C’est un tourisme de
grandes randonnées et de proximité, un peu coûteux,
mais ne nécessitant de pas beaucoup de moyens d’accueil. Il est surtout
présent dans le grand sud.
Il nous faut dire un mot de la santé. Le temps de
la gratuité absolue est pratiquement passé. Il est de plus
en plus difficile de se faire soigner ou opérer dans les structures
médicales d’état sans couverture sociale et sans appui dû
à des connaissances œuvrant dans les hôpitaux. Ceux-ce auraient
besoin d’une rénovation, de matériel, d’entretien, de médicaments.
Le personnel a beau y être souvent dévoué, cela ne
suffit pas à assurer des soins pour tous. Cela reste un point sombre
dans la vie économique du pays. Se faire soigner dans des cliniques
privées devient possible, mais à quel prix ? Pourtant, la
région ne manque pas de médecins. Une ville comme Timimoun
compte un médecin pour 100 habitants, ce qui n’est pas mal.
La carence de gynécologues est une réalité. Les médicaments
restent chers, et souvent les clients ne prennent de leur ordonnance médicale
que ce qu’ils peuvent payer au pharmacien. Le recours à des médecines
locales est inévitable, y compris aux talebs et aux guérisseurs,
dont l’efficacité reste très aléatoire.

|
La
vie culturelle et religieuse
Voici une dizaine d’années, nous avons vu se multiplier
les " paraboles " sur les toits et les terrasses, et nous
avons emboîté le pas. La différence est sans doute que
de notre côté, avons gardé une préférence
pour les chaînes européennes, et délaissé quelque
peu les chaînes arabes, car ce sont elles qui sont surtout visitées
et zappées par notre population du sud.
La " globalisation " est entrée dans la plupart des familles.
La référence aux chaînes arabes a développé
l’écart entre le monde occidental facilement assimilé au
monde chrétien et le monde oriental, assimilé au monde
musulman. Ceci est sans doute plus vrai pour le Sahara algérien
plus axé sur les chaînes de télé arabes.
Les radios locales se sont multipliées, étant donné
le coût assez bas pour investir dans ce domaine. Cela permet à
la population urbaine de suivre de plus près les événements
qui se passent dans la cité.
Mais deux autres instruments de communication et d’information
viennent s’infiltrer dans nos sociétés, c’est " l’internet
" et " le portable ". Ce dernier tend à supplanter les cabines
téléphoniques, obligés de se reconvertir à
cause de la concurrence.
Le portable est maintenant accessible à toute la population.
Son développement désenclave les oasis, et rend possible
la communication tous azimuts. Ce n’est pas sans importance pour
l’évolution de la façon de communiquer. J’ai vu, il y a peu
de temps, un touareg dans la région de Tam téléphoner
au rythme du balancement de son chameau… alors qu’il est interdit de téléphoner
au volant !
Avec le téléphone portable, vient l’internet et
le cybercafé. Ce dernier est en pleine expansion. La communication
se multiplie, et c’est une fenêtre de plus ouverte sur le monde.
Petit à petit, les ordinateurs entrent dans les maisons… personne
n’y échappe, même si la progression reste assez lente. De
toute façon, nombre de la nouvelle génération ont
leur e.mail, et consultent, ainsi que les différents sites accessibles.
Cela n’est pas sans conséquences sur l’évolution de la société.
Dans ce même champ culturel, je mettrais l’école
et l’enseignement en général. L’expérience
montre que son évolution est lente, et que l’un et l’autre (plus
particulièrement l’école) sont marqués par les dix
années passées. On ne peut faire faire à un pétrolier
un demi-tour en quelques minutes. Il lui faut du temps. Il en est de même
pour l’enseignement. Le fait que le français soit au programme
de la seconde année primaire ne va pas tout de suite avoir une
influence sur l’accès au savoir dans cette langue si les enseignants
ne sont pas préparés à former leurs élèves.
Il y a là une demande qui nous interpelle et nous sommes
sollicités dans ce domaine.
Pour ce qui est des universités, elles se multiplient
dans le Sud. Les facultés ne sont pas toujours très adaptées
aux besoins du lieu. Là encore nous sommes sollicités
pour une aide d’appoint en soutien linguistique et méthodologique,
et aussi en matière d’apport de livres par le biais de bibliothèques
que nous sommes amenés à spécialiser. Cela reste
modeste au vu des besoins.
Le plus dramatique, c’est que l’école et l’université
continuent à former de jeunes chômeurs qui ont de
plus en plus de mal à s’intégrer dans la société,
faute de travail. Leur dignité même est amputée, et
ils peuvent devenir la proie d’une désespérance et d’un mal
vivre qui peuvent se prêter à des manipulations, comme c’est
le cas dans de nombreux pays. Quoi qu’il en soit, beaucoup sont embauchés
pour de petits boulots qui permettent de survivre, mais pas de construire
un avenir.
Pouvons-nous, à notre niveau, élargir notre champ
d’engagement ? Comment le faire ? La question est posée.
Il est difficile de bien cerner le champ religieux. Mais
il s’est considérablement diversifié au gré des
quartiers, des lieux, des mosquées. Nous ne pouvons pas dire
que nous évoluons vers un monde qui se modèlerait sur
une société de type laïque. Plusieurs courants traversent
la société musulmane.
Ce que nous remarquons, et la presse locale en fait mention, c’est
la persistance d’un certain " islamisme ", qui a certes perdu de sa violence,
mais qui garde le rêve d’une société bâtie
sur la "Charia".
Cela ne signifie pas un durcissement de la société.
Il y a plusieurs façons de pratiquer l’Islam, peut-être
davantage que voici quelques années. Il reste bien présent
dans le champ social, mais il se diversifie. Il reste porteur de sens,
ou, plus encore de recherche de sens, et cette recherche de sens est sans
doute le lieu où nos chemins se croisent le plus profondément.
Une autre constatation faite, c’est la " renaissance " du mouvement
confrérique. Je ne dispose pas de statistiques, mais il est
un fait que les Confréries réoccupent le champ religieux.
Ce développement donne à l’Islam une base populaire, issue
de son histoire et de son développement dans la région.
|
Un regard sur ce monde où
nous vivons : le Sahara d' aujourd'hui
par Mgr Claude Rault
|
 (cliquez sur les mots soulignées pour accéder
aux chapitres correspondants)
(cliquez sur les mots soulignées pour accéder
aux chapitres correspondants)